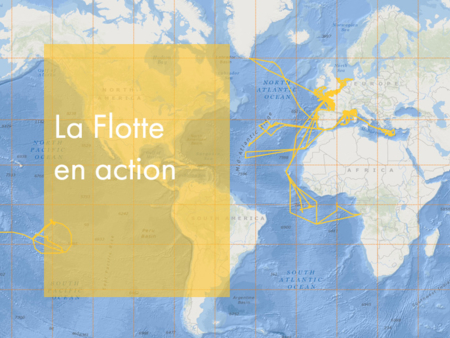Biologie marine et biodiversité
Plus vaste habitat sur Terre, l’Océan demeure pourtant le moins exploré. « Au milieu du XXe siècle, on pensait connaître 80 % de la biodiversité marine. À la fin du XXe siècle, on s’est rendu compte qu’en réalité, on n’en avait décrit qu’une part infime. Y compris dans l’océan Atlantique, il reste beaucoup d’inconnues », rappelle Sarah Samadi, professeure au Muséum national d’Histoire naturelle. Au début du XXIe siècle, un second constat est venu s’ajouter : la nécessité d’agir vite. « Avec l’accélération de l’incidence des activités anthropiques, la biodiversité disparaît avant même d’avoir été étudiée », poursuit la spécialiste des organismes benthiques qui coordonne le groupe de travail « Biologie marine », dans le cadre de la démarche « Imaginons la Flotte océanographique française à l’horizon 2035 ».
Face à cette réalité, il semble tout d’abord nécessaire de démultiplier les échantillonnages. « Auparavant, on allait essentiellement là où étaient positionnés les bateaux et où l’on savait qu’il y avait une vaste biodiversité à décrire, particulièrement dans le Pacifique.
Aujourd’hui, il y a plus de campagnes ciblées sur des territoires français, comme Saint-Paul et Amsterdam ou les îles Éparses. Ces territoires ont pris conscience de l’importance d’améliorer la connaissance fondamentale de leur biodiversité. On continue à penser qu’il faut aller voir ailleurs, car on ne peut pas dire grand-chose de l’originalité d’un endroit si on ne le compare pas avec ce qu’il y a autour. »
" Il faudrait rendre accessibles les échantillons biologiques de toutes les campagnes à toute la communauté comme c’est le cas pour les carottes océaniques."
Sarah Samadi, professeure au Muséum national d’Histoire naturelle
Au-delà de cette évolution, il paraît essentiel de construire une stratégie à l’échelle mondiale pour corriger les biais de représentation de la biodiversité et obtenir une connaissance solide. « On a trop tendance à généraliser à partir de données issues d’une même zone, d’un seul type d’habitat ou d’un seul type d’organisme. Une vision plus intégrée est nécessaire. Certains organismes, par exemple, vivent dans le plancton à l’état larvaire et sur le fond à l’état adulte. Pour comprendre les interactions qui en découlent, il faut imbriquer l’étude de plusieurs compartiments. C’est comme les poupées russes ! », résume Sarah Samadi.
La biologie doit répondre aux enjeux de science ouverte : « Il faudrait rendre accessibles les échantillons biologiques de toutes les campagnes à toute la communauté comme c’est le cas pour les carottes océaniques ». L’objectif est de valoriser les échantillons acquis sur un plus long terme. « Une campagne qui alimente des recherches pendant cinquante ans n’a pas le même coût carbone qu’un projet qui ne dure que trois ans ».
Au sein du groupe de travail « Biologie marine », de nombreuses pistes sont discutées pour réduire l’empreinte environnementale de la recherche, parmi lesquelles l’optimisation des campagnes, la valorisation des transits et l’implication plus forte des équipages. Pour Sarah Samadi, les nouvelles technologies ne résoudront pas tout : « On a encore besoin d’échantillonner avec des outils conventionnels et de petits bateaux polyvalents qui offrent plus de souplesse dans leur configuration. »